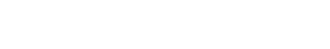La ville surveillancielle et au-delà : éléments de réflexion sur la visibilité urbaine


Olivier Aïm, Contributeur chez Urban AI, est maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication au Celsa (Sorbonne-Université). Ses recherches portent sur l’histoire et la philosophie de la communication, la théorie des médias et des formes culturelles. Il est notamment l’auteur de Les Théories de la Surveillance, du Panoptique aux Surveillances Studies.
Comme toutes les notions qui cherchent à embrasser un ensemble de mutations techniques et de « sauts technologiques » (Michel Foucault), la « ville numérique » s’inscrit dans une histoire irréductible au seul moment de sa proclamation. « Ville connectée », « ville sûre » (safe city), « ville intelligente » (smart city) sont les formulations récentes d’un phénomène d’urbanisation qui s’amorce dès le XVIIIe siècle et qui n’a fait que s’intensifier avec le temps. Or, l’urbanisation est elle-même un processus qui engage, depuis l’origine de ses réflexivités, la question de l’abstraction. Peut-être même que la ville est le lieu par excellence de la mise en miroir et en dialogue de ces deux formes d’intelligence : celle des individus au sein de l’espace public, d’une part ; celle des données qui y sont captées ou affichées, d’autre part.
L’urbanisation comme processus d’abstraction
En tant que représentant de la philosophie de la Modernité, Georg Simmel [1] est le premier, dès la fin du XIXe siècle, à identifier l’évolution « sensorielle » et « intellectuelle » de l’expérience urbaine : parce qu’elle procède avant tout d’une multiplication des « stimulations » nerveuses et informationnelles, la « vie de l’esprit dans la grande ville » se manifeste par une montée en puissance du repli sur soi à la faveur de toutes sortes d’opérations mentales essentiellement liées au calcul. L’évolution des appareils et des machines, autrement dit des « technologies intellectuelles » (Jack Goody), n’a eu de cesse d’amplifier et d’externaliser ce mouvement. Bien entendu, l‘évolution des médias fait que l’externalisation en jeu s’opère de plus en plus sous la forme d’interfaces : non seulement du côté des individus habitant ou traversant les villes, du fait qu’ils sont toujours plus équipés d’outils de lecture et de consultation de données de toutes sortes (smart-technologies). Mais aussi du côté des espaces urbains, espaces sémiotiques eux-mêmes dotés de capteurs, d’écrans de contrôle et d’espaces d’affichage. Sans compter que l’émergence des métropoles est indissociable de celle des médias de masse : publicité, presse, cinéma, etc. Dans tous les cas, la question vive est celle de l’information. C’est pourquoi la théorie de la ville « intelligente » s’inscrit plus précisément dans l’histoire de ses dispositifs d’écriture (la grammatisation), d’information (la cybernétique) et de calcul (l’algorithmique).
« Ville panique », ville panoptique
Dans ces conditions, il n’est guère étonnant qu’une première description de la ville se soit engagée dans une approche en termes de conflictualité et de panique. La « ville panique » est, ainsi, une notion proposée par le philosophe Paul Virilio dès 1980 pour décrire plusieurs phénomènes convergents autour d’une accélération de l’urbanisation, selon lui, sans précédent. Elle désigne la transformation massive et rapide des habitations (ensembles, immeubles, tours), des circulations et de leur contrôle, qui va de pair avec l’informatisation des dispositifs de gouvernance. La « ville panique » de Virilio recoupement très largement ce que l’on pourrait dénommer la « ville panoptique ». N’oublions pas, du reste, que, chez Foucault [2], le panoptisme prend appui sur une théorie de l’urbanité, au sens où la ville devient, selon lui, à l’époque moderne, le réceptacle des « ‘urgences » sur lesquelles les dispositifs de surveillance et de discipline doivent agir : à savoir les menaces épidémiques et sécuritaires. Pour Foucault, la réponse est de l’ordre d’une rationalité croissante, relative aux normes de circulation, aux procédures de quadrillage et aux mises en documents de la population. De ce point de vue, le panoptisme est l’autre nom de la rationalisation de l’espace urbain. Telle est également la lecture qu’en donne Michel de Certeau lorsqu’il observe l’assimilation, au cours des années 1970, du « fait urbain » à un « ratio urbanistique« , soumis à des opérations « »spéculatives » et classificatrices », reposant elles-mêmes sur une logique supérieure de « lisibilité » et de « totalisation » de l’espace public à des fins de gestion et de domination [3].

De l’ubiveillance à l’urbiveillance ?
Au cœur du projet épistémologique des Surveillance Studies qui se structurent au début des années 2000, il est tout à fait logique que l’on retrouve alors la question urbaine. Notamment parce qu’elle cristallise de manière concrète et empirique toute une série de phénomènes qui rendent visibles les enjeux sécuritaires et surveillanciels : à commencer par l’installation de dispositifs de télésurveillance au sein des espaces publics, des espaces urbains et des espaces marchands. Une dialectique fondamentale apparaît pour les chercheurs : la ville capte les visibilités, tout en posant la double question de la propre visibilité de ses dispositifs de surveillance (à des fins de dissuasion) et de leur invisibilisation progressive (à des fins d’efficacité). Ce faisant, c’est la notion même de visibilité qui change de visage, si l’on peut dire. Ainsi que l’écrit en 2002 Gary T. Marx, [4] l’un des fondateurs des Surveillance Studies, la visibilité n’est plus seulement de l’ordre de la « visualité », mais entre dans un champ sensoriel élargi et lui-même évolutif : celui des données, de natures extrêmement variées. On entre ainsi dans le cadre de la « nouvelle surveillance » souvent assimilée à la « dataveillance » ou à l' »ubiveillance » en lien avec l’évolution de l’informatique de plus en plus conçue comme « ubiquitaire » et « ambiante »[5].
Les évolutions numériques et algorithmiques creusent cette dialectique. Il n’est que de penser à la question brûlante de la reconnaissance faciale qui fait apparaître les nouveaux enjeux de l’asymétrie de la perception des visages, renforcée par la nature à la fois visuelle et non visuelle de leur lecture. Sans parler des caméras thermiques qui codent encore différemment les opérations de détection et de visualisation des corps. De manière significative, les caméras combinent désormais un triple enjeu de surveillance : l’enregistrement d’images, la capture de données, le calcul de profils.
La visibilité comme pragmatique
Tantôt concrète, tantôt abstraite, la visibilité est donc plus que jamais centrale et relève de ce qu’il convient d’appeler une « pragmatique »[6] et non plus seulement une « économie ». Face à l’emprise réelle ou fantasmée de la « gouvernementalité algorithmique », les individus entrent dans des logiques de défiance et de détournement qui consistent à se rendre invisibles, indétectables ou « furtifs ». Dans le cas de la reconnaissance faciale, le corps et le visage sont appelés à devenir ainsi le siège de nouvelles performances au sein même de l’espace urbain par le vêtement, le maquillage, la coiffure ou tout autre vecteur d' »obfuscation » [7]. C’est la revanche de la « contre-visualité » (Nicholas Mirzoeff) la plus physique sur la toute-visibilité numérique ! Si bien que les « tactiques » des individus produisent des formes inattendues d’expression et d’esthétisation (citons par exemple le cas du collectif anglais The Dazzled Club).

Au fond, ces premiers éléments nous rappellent que toute pragmatique est aussi une poétique et une éthique. En ce sens, la question de la visibilité demeure l’entrée théorique et empirique principale pour concevoir une nouvelle « poétique de la ville » au sens que donne l’anthropologie (celle de Michel de Certeau ou de Pierre Sansot) à ce programme : celui des dérives ou « des mouvements contradictoires qui se compensent et se combinent hors du pouvoir panoptique ». Soit tout un art du « braconnage » que Michel de Certeau place sous le signe de Kandinsky, qui énonçait qu' »une grande ville [doit être] bâtie selon toutes les règles de l’architecture et soudain secouée par une force qui défie les calculs. » [8].
En cela, la leçon historique de ces nouvelles formes de l’intelligence en milieu urbain est que l’utopie de la ville numérique n’est pas uniquement à chercher dans une « autre spatialité ». Elle doit engager un usage autre des données et des « captures », qui ne ressortissent pas seulement à une logique descendante de contrôle ou de « captation de l’attention ». On peut citer alors les propositions heuristiques d’Yves Citton autour de la notion d' »écologie de l’attention » et de « technologie de l’enchantement » [9]. Il ne s’agit pas de rejeter dans un mouvement de panique technologique les potentialités des nouveaux outils, mais de refuser qu’ils ne nous « envoûtent » que sous la forme de l’injonction, de l’alerte, de la mobilisation (Maurizio Ferraris). Il s’agit ainsi d’envisager l’intelligence artificielle et algorithmique dans la capacité qu’ils offrent de réorganiser et de réarmer nos expériences et nos sensorialités : l’invitation plutôt que la commination, le kaïros plutôt que l’opportunisme, la « xenitia » (Barthes) plutôt que la « disparition de la disparition » [10], des « lignes de fuite » plutôt que des « machines de capture » (Deleuze).
C’est bien entendu un immense défi qui se présente à nous, ou plutôt qui se révèle maintenant dans toute sa puissance. Un défi qui rejoint d’autres questions déjà bien identifiées dans leur ambivalence panique : la transparence, l’ouverture, la participation. Un défi, enfin, qui nécessite pour être relevé de passer par une rematérialisation des flux de données. Pour reprendre les termes de Simmel, la vie de l’esprit dans la grande ville numérique doit dépasser le visible comme conflit pour réinvestir le sensible comme partage.
Par Olivier Aïm
[1] : Georg Simmel, Les grandes villes et la vie de l’esprit, Payot, 2013 [1903]
[2] :Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975[3] : Michel de Certeau, « Pratiques d’espaces. La ville métaphorique », Traverses, n°9, 1976
[4] : Gary T. Marx, « What’s New About the “New Surveillance”? Classifying for Change and Continuity », Surveillance & Society, Vol 1 n°1, 2002
[5] : Mark Weiser, « The Computer for the 21st Century », 1991
[6] : Olivier Aïm, Les Théories de la surveillance. Du panoptique aux Surveillance Studies, Armand Colin, 2020
[7] : Helen Nissenbaum et Finn Brunton, Obfuscation, C&F Editions,2019
[8] :Du spirituel dans l’art, 1969
[9] : Yves Citton, « Techniques de résistance aux sociétés de contrôle : l’anti-gestion selon Roland Barthes », in Technologies de contrôle dans la mondialisation : enjeux politiques, éthiques et esthétiques, Kimé, 2009
[10] : En proposant le concept décisif d' »agencement surveillanciel », les deux sociologues et juristes Haggerty et Ericson sous-titrent leur article ainsi nommé de l’expression « la disparition de la disparition ». Il s’agit bien entendu d’entendre cette formule comme une menace que les nouvelles capacités de capture des données font peser sur l’expérience urbaine en tant que liberté de passer, de flâner et même de se perdre.